Leadership :
Le gong a-t-il déjà sonné ?


La France au bord de la faillite, l’Allemagne en proie à la récession : les deux puissances motrices de l’Union européenne sont dans l’incapacité de déployer un puissant leadership. Un constat qui inquiète au moment où l’histoire s’accélère.
L’attaque à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine a eu pour conséquence première de renforcer la cohésion de l’UE et la conviction qu’il était désormais indispensable d’investir dans une capacité de défense autonome. Deux ans et demi plus tard, la situation est tout autre. Un sentiment de lassitude et d’accablement s’est emparé de nombreux pays, notamment du fait de la multiplication des conflits géopolitiques. Et même au plus haut niveau, les chefs d’État et de gouvernement ne cachent plus leurs divergences de vue sur l’Ukraine. Dans un contexte d’incertitude renforcée par les élections présidentielles aux États-Unis, la France et l’Allemagne auraient tout intérêt à déployer un puissant leadership. Or, depuis la conférence de soutien à l’Ukraine organisée à Paris le 26 février dernier et les déclarations du président Macron sur l’envoi de troupes occidentales en Ukraine, la rupture entre les deux partenaires semble consommée.
Les États-Unis se détournent de l’Europe
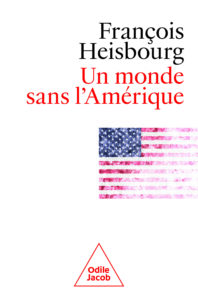
Cela est d’autant plus grave que, quel que soit le résultat des élections, les États-Unis vont poursuivre leur retrait d’Europe. C’est du moins le pronostic que François Heisbourg formule dans son dernier livre, » Un monde sans l’Amérique « . Partant de Barack Obama, Heisbourg y décrit le déplacement du centre de gravité des intérêts américains vers l’Indopacifique : » Il n’y aura pas de retour à la normale « , affirme l’analyste. « Les États-Unis sont dans un état d’hésitation mortel pour l’Ukraine. Nous autres Européens auront vite à en subir les conséquences. « Interrogé sur les perspectives qu’ouvrirait une victoire de la candidate démocrate Kamala Harris, Heisbourg temporise : » Avec Donald Trump, le choc serait brutal. Avec Kamala Harris, les Européens seront (…) tentés de croire que les choses continueront comme avant. Ce serait une position néanmoins dangereuse. «
La France ne peut plus, l’Allemagne n’y croit plus
Hors-jeu du fait de la crise politique qu’il a provoquée en dissolvant l’Assemblée nationale, le président Macron n’a plus les moyens d’assurer le leadership qui était le sien depuis 2017 – même s’il dit vouloir désormais se concentrer sur la politique étrangère, européenne principalement. La situation des finances publiques n’arrange en rien les choses. À l’été, la Commission européenne a lancé une procédure contre sept États membres, dont la France, pour déficits publics excessifs. Un coup dur pour le président car pour peser à Bruxelles, il faut respecter les traités ; un pays qui fait l’objet d’une procédure pour déficit excessif n’est tout simplement pas crédible.
Après son départ de Bruxelles, Thierry Breton a parlé, s’agissant de la Commission, d’un déséquilibre en faveur de l’Allemagne. On peut y voir la conséquence de son » limogeage » par la présidente allemande de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (CDU). Il n’en reste pas moins que ses propositions sur la fin du moteur franco-allemand doivent être prises très au sérieux. » Je suis un défenseur acharné de l’axe franco-allemand « , a déclaré l’ancien commissaire, » mais aujourd’hui, le moteur ne fonctionne plus. Peut-être que l’Allemagne n’y croit plus « . Le mérite de Michel Barnier et de son ministre de l’Economie et des Finances est de ne pas cacher la gravité de la situation aux Français : » Notre dette publique est gigantesque « , déclara Antoine Armand lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2025 le 10 octobre dernier. On ne sait pas encore si et comment il passera l’épreuve de l’Assemblée avec ses hausses d’impôts et économies de 60 milliards d’euros. (…)
La première victime de cette nouvelle politique d’austérité est l’Ukraine pour laquelle l’aide militaire sera finalement moins importante qu’annoncée. « Début 2024, nous avons pris la décision de fournir jusqu’à trois milliards d’euros d’aide militaire à l’Ukraine. Dans les faits, nous serons à plus de deux milliards, mais pas à trois « , a reconnu le ministre de la Défense Sébastien Lecornu devant la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Dernièrement, la France a fortement augmenté son budget militaire. La loi de programmation militaire pour les années 2024 -2030 prévoit 413 milliards d’euros de dépenses, soit près d’un tiers de plus que sur la période précédente. De son côté, l’Allemagne a fait passer son budget défense à près de 52 milliards d’euros en 2024. Pour la première fois, il atteint l’objectif des 2% prévu par l’OTAN.
Un élève modèle ?
Le gouvernement allemand n’a en outre de cesse de rappeler qu’il est le deuxième plus grand soutien de l’Ukraine après les États-Unis. Mais si l’on s’en tient aux statistiques du célèbre Kieler Institut für Weltwirtschaft, il apparaît que Berlin est loin d’être un élève modèle. L’Allemagne est certes bien installée à la deuxième position, à la troisième si l’on intègre l’UE au classement (la France est passée de la 13ème à la 10ème place). Ramené au PIB, le compte n’y est cependant pas, l’Allemagne n’arrivant qu’en 14ème position, avant la Bulgarie et la France. Dans le contexte géopolitique actuel, » l’Europe est la grande perdante de la nouvelle donne issue de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, marquée par l’éclatement de la mondialisation et la confrontation entre les empires autoritaires et les démocraties « , affirme Nicolas Baverez dans Le Point. » Elle devient une zone de déclin démographique et de stagnation économique, tout en se découvrant désarmée face à l’impérialisme de la Russie et à l’affaiblissement de la garantie de sécurité des États-Unis. »

L’avenir sera écrit par les autres
Dans le même temps, Baverez croit voir un changement radical des rôles au sein de l’UE. Alors que les pays d’Europe du Sud, du Nord et de l’Est auraient fait preuve d’une plus grande résilience face aux chocs géopolitiques, énergétiques, économiques et sanitaires récents, Paris et Berlin, seraient eux les » hommes malades » de l’Europe. Son jugement est sans appel : » La France est devenue l’Argentine de l’Europe … « , l’Allemagne est en panne, en proie à une deuxième année de récession et confrontée à une diminution de sa production industrielle. Baverez voit dans cette évolution un problème non pas conjoncturel mais structurel, » provoqué par le déclin démographique, la perte de compétitivité due aux prix élevés de l’énergie et au manque de main-d’œuvre qualifiée, l’héritage de décennies de sous-investissement, le joug de la bureaucratie et le poids de la fiscalité « . Les difficultés que rencontre l’industrie allemande, la baisse des exportations du pays et la vague de délocalisations à laquelle il doit faire face lui font dire que le modèle économique allemand, tourné vers l’exportation, est aujourd’hui dépassé. L’état de l’industrie automobile en est à ses yeux le symbole. (…) Et de conclure, l’Europe du 21ème siècle ne sera pas celle telle que voulue par la France et l’Allemagne mais (…) par le sud, le nord et l’est du continent.
© 2024 LE MONDE
Cette contribution est une version abrégée d’un article publié dans le quotidien allemand Die Welt le 29 octobre 2024 ( » Il n’y a pas de retour en arrière possible. « )
L’auteure

Martina Meister travaille depuis plus de vingt ans comme correspondante en France. Après avoir écrit sur des sujets culturels, politico-culturels et sociaux, elle est aujourd’hui correspondante politique pour DIE WELT & DIE WELT AM SONNTAG. Elle a traduit François Duby en allemand, a fondé le magazine en ligne « Mad about Paris » et est l’auteure du livre » Filou ou heureux avec un chien ».


