Le monde d’avant est mort

Dans son livre » Un monde sans l’Amérique « , François Heisbourg s’interroge sur le positionnement des États-Unis dans un monde de plus en plus fragmenté. Publié en septembre, le livre est dans le contexte de l’élection de Donald Trump d’une brûlante actualité.
Pour l’auteur d’un essai prospectif, il peut y avoir un sort plus pénible que de voir les faits démentir ses analyses et prévisions. Il est parfois encore plus pénible de voir se confirmer ses hypothèses, notamment les plus dérangeantes. C’est ce qui m’est arrivé en prenant fort au sérieux dès la genèse de l’ouvrage la possibilité que Donald Trump serait réélu, cependant que son parti conserverait la majorité de la Chambre des Représentants tout en emportant la majorité au Sénat. Pire, la suggestion que l’Amérique prrait ses distances par rapport au monde est depuis lors passée du statut de provocation improbable à une hypothèse de travail allant pratiquement de soi après l’annonce des futurs responsables de l’administration Trump 2.0. J’aurais préféré que le titre, » Un monde sans l’Amérique « , que j’avais choisi ne prenne pas aussi brutalement un aspect prémonitoire.
Une Amérique moins engagée
Le paradoxe est que les thèses de mon livre ne sont pas dans bien des cas propres à Trump, mais correspondaient à des changements dans la société américaine de manière plus large. Ainsi, force m’était de constater que Biden et Trump, entre la campagne électorale de 2020 et celle de 2024 se trouvaient en accord dans trois grands domaines, ceci valant par extension pour la vice-présidente Kamala Harris. L’un comme l’autre, avaient promis de mettre fin aux forever wars, les guerres incessantes, notamment en Afghanistan, et de ne pas en commencer de nouvelles. C’est ainsi que l’administration Trump avait négocié les accords de Doha avec les Talibans en 2020, suivi par la décision de Biden de les appliquer à sa manière avec le retrait précipité de Kaboul en 2021.
S’agissant de l’Iran, Trump avait certes ordonné l’assassinat du général Soleimani en 2020, mais il n’avait pas frappé en Iran même. Biden a pour sa part apporté aide et assistance militaire à l’Ukraine à partir de 2022, mais sans engager des forces américaines dans le théâtre des opérations. Et le président-élu a rappelé dans son discours post-électoral à Mar-a-Lago son intention de mettre fin aux conflits plutôt que de s’y engager. Le fardeau de l’empire pèse visiblement de façon désagréable sur les épaules de chacun.
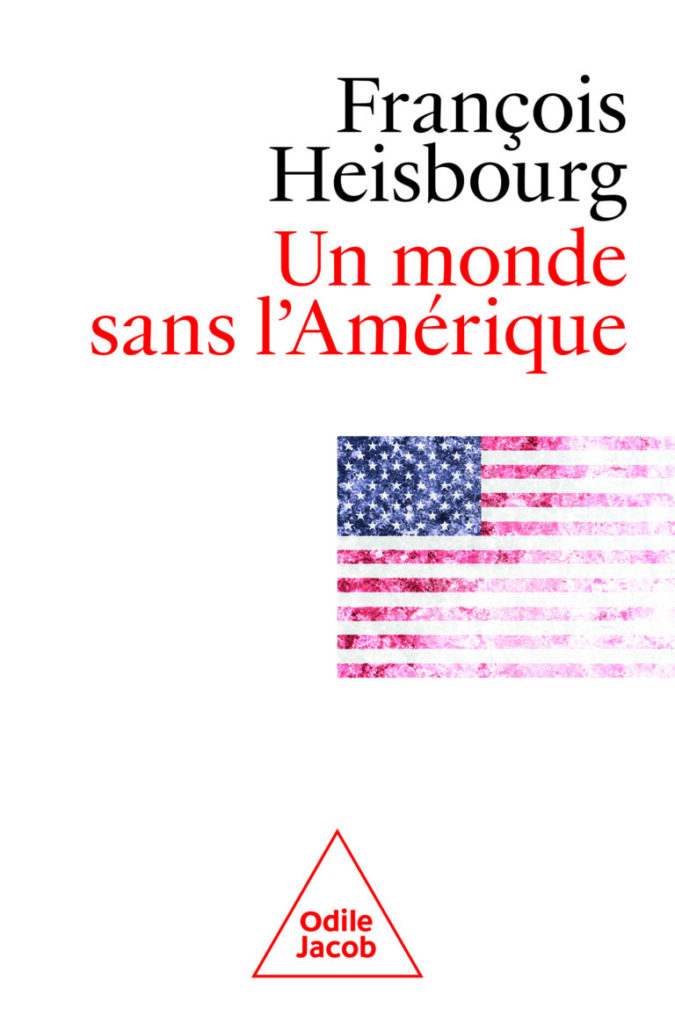
Même consensus sur la hiérarchie des priorités stratégiques américaines dans le monde : la Chine et la région Indopacifique sont au centre des préoccupations. Cela est vrai non seulement des candidats Biden/Harris et Trump, mais de manière plus générale au Congrès ainsi que dans l’écosystème washingtonien des think-tanks comme des agences et ministères. Enfin, Trump et Biden ont une vision protectrice de l’économie et des relations commerciales internationales, en rupture idéologique et pratique avec l’ensemble de la période d’après la Deuxième Guerre mondiale.
Certes, il y a des différences profondes dans la manière dont Trump et Biden/Harris approchent ces zones de convergence : pendant son premier mandat, Trump n’excluait pas la possibilité d’une transaction avec le président chinois. Sous Biden, les vues sur la guerre d’Ukraine étaient loin d’être convergentes. Dans le domaine commercial, Trump proclame la centralité des droits de douane cependant que Biden privilégiait davantage le recours aux subventions publiques. Mais l’ensemble de ces facteurs communs dessinent les traits d’une Amérique moins engagée dans le monde et moins présente en Europe. L’Amérique, et pas seulement celle de ces électeurs est au diapason de cette évolution – qui, sous Trump prendra les allures d’une contre-révolution à rebours de ce qu’ont été les Etats-Unis dans le monde depuis 1941.
Une puissance en déclin ?
A l’inverse, je ne prends pas à mon compte la thèse périodiquement réitérée d’une Amérique dont la puissance serait aujourd’hui sur le déclin. L’économie américaine connait une croissance sans commune mesure avec celle de l’Europe, et particulièrement l’Allemagne, et sa capacité d’innovation technologique est intacte. Sa capacité de projection de force à l’échelle mondiale demeure sans égale, même si la Chine menace sa primauté en Asie-Pacifique. S’il y a aujourd’hui déclin, il a lieu surtout dans les têtes : outre-Atlantique, l’envie manque désormais de changer le monde plutôt que l’Amérique. A l’inverse, sous Trump le déclin menacera, si le protectionnisme plonge l’économie mondiale dans la crise et si l’aversion profondément ancrée du président-élu pour les alliances permanentes devait détourner d’elle ses partenaires actuels.
L’Europe ? Une » sous-Chine

Pour l’Europe, le défi est de première ampleur et d’autant plus difficile à relever que nombreux sont ceux et celles qui sont dans le déni. Il est vrai que la politique de l’autruche est d’autant plus tentante que la réalité outre-Atlantique est désolante. Trump récuse l’idée même d’alliance, et spécialement l’OTAN, la plus importante d’entre elles. Trump a une Europe qu’il voit comme une sorte de » sous-Chine » (pour employer une de ses formules pendant la campagne présidentielle) mais en plus faible. Il méprise la France et voue une détestation particulière pour l’Allemagne. Pour Trump et ses partisans, il n’y a point de garantie de défense inconditionnelle au sein de l’OTAN, seulement une protection racket précaire et révocable rappelant les mœurs régnant dans l’univers interlope du real estate newyorkais.
nature de la transaction qu’envisage Trump autour de l’Ukraine n’étaient pas encore connus avec précision. Nous savons seulement que Trump a des liens anciens et plutôt chaleureux avec Vladimir Poutine. Nous savons aussi que Trump a dit en février dernier qu’il encouragerait les Russes à faire ce qu’ils voudraient ( » the hell what they want « ) à l’encontre des pays européens qui n’auraient pas payé leur écot.
Rien de ce qui précède concernant l’OTAN et l’Europe n’est nouveau ou conjoncturel : Trump reprend ces idées depuis près de quarante ans maintenant. L’homme est stratégiquement constant et non le bravache imprévisible parfois dépeint par les Européens.
Face à son destin
Pour l’Europe et les Européens, la première urgence est de recouvrer une gouvernance politique capable de prendre des décisions : dans mon livre, cette observation visait (et vise toujours) la France à l’issue de ses élections anticipées. Aujourd’hui, elle vise davantage encore l’Allemagne dont les prochaines élections seront d’une importance cruciale pour l’Europe. Toute aussi pressante est la nécessité d’éviter que la Russie gagne la guerre en Ukraine, une telle victoire ouvrant le chemin à d’autres aventures impériales en Europe, surtout si Moscou cédait à la tentation de tester l’article 5 de l’OTAN. Je décris dans mon ouvrage à quoi pourrait ressembler une attaque contre la Lituanie et les soldats allemands qui s’y trouvent. Afin d’éviter d’en arriver là, mieux vaut pour les Européens de se préparer à remplacer les Etats-Unis si l’aide de Washington à l’Ukraine devait être réduite ou coupée. Cela coûtera beaucoup moins cher que de vivre avec les conséquences de la défaite de l’Ukraine.
Ce qui vaut dans l’immédiat face à la guerre d’Ukraine vaut aussi pour l’OTAN de façon plus générale. Si les Etats-Unis ne deviennent plus qu’un partenaire dormant au sein de l’OTAN, ce sera aux Européens de faire de l’Alliance Atlantique leur outil. Sous Trump 2.0, il n’y a plus de général Mattis à Washington pour sauver les meubles. Dans tous les cas, la fin rapide d’un frein à l’endettement (Schuldenbremse) qui a cessé de faire sens est une nécessité évidente, désormais largement comprise en Allemagne.
Si nous ne faisons pas face à ces urgences absolues que sont le rétablissement d’une gouvernance solide en Allemagne et en France d’une part, la sécurité et la souveraineté de l’Ukraine d’autre part, » tout le reste » devient hors sujet. Seule une Union européenne défendue sera en mesure de résister à l’étau protectionniste américain et chinois, de renouer avec la compétitivité économique et technologique et à mener une politique efficace contre le changement climatique. Sachons-le . Le monde d’avant est mort.
L’auteur
François Heisbourg est conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique et Senior Advisor de l’IISS pour l’Europe. Sa carrière a embrassé la diplomatie, le cabinet du ministre de la Défense et l’industrie militaire. Il a été professeur à Sciences-Po Paris et président du centre de politique de sécurité de Genève. .


