« Mein Kampf » à travers le prisme de la critique historique
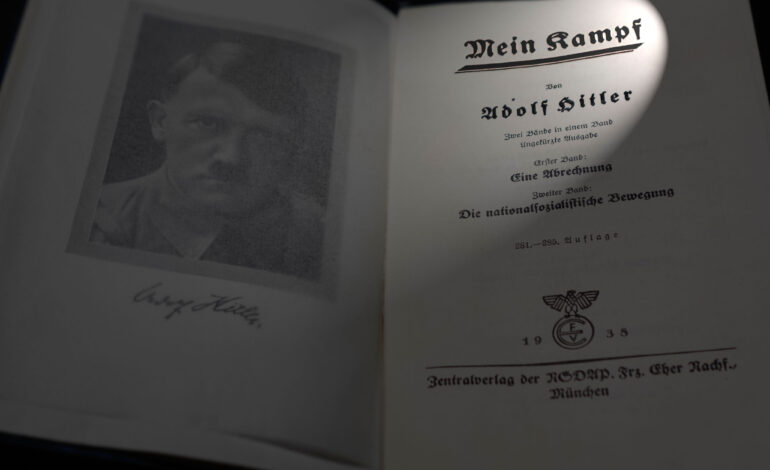
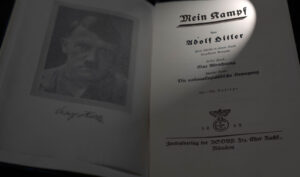
« Mein Kampf » est une source fondamentale pour comprendre l’histoire du XXe siècle. Florent Brayard et son équipe en ont proposé une analyse critique, une mise en contexte, et une déconstruction, ligne par ligne.
Au début des années soixante, le ministère bavarois des Finances se vit rétrocéder le droit moral d’Adolf Hitler, saisi en même temps que tous ses biens par les autorités d’occupation à la suite de la défaite allemande. Afin d’éviter toute exploitation commerciale ou idéologique de Mein Kampf, l’instance fédérale décida d’en interdire toute nouvelle édition. Aucun exemplaire ne fut imprimé en Allemagne au cours des soixante-dix ans qui suivirent la mort de Hitler alors que, de son vivant, plus de 12 millions d’exemplaires avaient été produits et distribués. Pour autant, Mein Kampf n’a jamais cessé de circuler. De nombreux exemplaires avaient survécu dans les bibliothèques familiales à l’effondrement et il fut bientôt autorisé de les vendre d’occasion. L’avènement d’Internet facilita encore un peu plus l’accès à l’ouvrage, sous une forme cette fois dématérialisée. Mein Kampf fait donc pleinement partie depuis un siècle de notre univers matériel et désormais numérique, et il n’est plus possible de l’en soustraire.
Pas de réédition, donc pas d’édition critique
Un domaine cependant a été particulièrement impacté par cette interdiction, celui de la recherche historique. Une des raisons d’être des historiens est de mettre à la disposition du public – sous la forme spécifique et codifiée de l’édition critique – les sources indispensables à la compréhension du passé. Hitler a suscité son lot de publications posthumes de sources, sous des formes chaque fois monumentales qui reflètent l’importance de son rôle dans l’histoire. L’Institut für Zeitgeschichte, le centre de recherche de Munich, a ainsi publié, entre 1991 et 2000, une série rassemblant l’ensemble des discours, écrits et ordres de Hitler couvrant la période de 1925 à 1933. La série compte 17 volumes au total, de plusieurs centaines de pages chacun ! Bref, on a au fil du temps publié tout ce qu’on a retrouvé de la main de Hitler, jusqu’aux cartes postales que, tout jeune homme, il avait envoyées depuis Vienne. Tout, sauf Mein Kampf, c’est-à-dire la source la plus importante et qui, en toute logique, aurait dû trouver sa place au cœur de la série de l’IfZ.
Deux historiens ont cependant défié l’interdiction et proposé dès 1994 une édition critique, bien que partielle, de l’ouvrage. Moshe Zimmermann et Oded Heilbronner disposaient il est vrai d’une légitimité incontestable : leur édition était publiée en hébreu, à Jérusalem, par un éditeur universitaire. Engager des poursuites à leur encontre sur la base du droit moral de Hitler aurait été indécent. Leurs confrères en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne ou aux Pays-Bas – pour ne citer que les pays où une édition critique complète a été publiée ces dernières années – ont quant à eux dû attendre patiemment la fin du copyright, 70 ans après la mort de l’auteur. L’« œuvre » de Hitler devait en effet tomber dans le domaine public le 1er janvier 2016 : n’importe qui pourrait alors proposer sa propre édition sans encourir les foudres du ministère bavarois.

Anticiper la fin du copyright
En amont de cette date, deux équipes ont commencé à préparer une édition critique de Mein Kampf : l’Institut für Zeitgeschichte à Munich et les éditions Fayard à Paris. C’est l’édition allemande qui parut en premier, en janvier 2016. La publication de Hitler. Mein Kampf. Eine kritische Edition déclencha un engouement médiatique mondial, ce qui, rétrospectivement, n’est guère surprenant. Il s’agissait de la première nouvelle édition en langue allemande depuis la fin de la guerre et surtout de la toute première édition critique intégrale. Forte de deux volumes grand format, elle était, qui plus est, d’une exigence remarquable : côté français, l’équipe constituée sous ma direction ne put dès lors imaginer reprendre le dossier à zéro, comme si de rien n’était, sans s’appuyer sur l’exemplaire travail effectué outre-Rhin. On comprendra notre soulagement quand l’Institut munichois, par la voix de son directeur, Andreas Wirsching, accepta le principe d’une adaptation en français de son appareil critique.
Celui-ci est d’une précision sans faille. L’équipe allemande sous la direction de Christian Hartmann a eu par exemple à cœur de retrouver les sources qui avaient inspirées Hitler, une tâche complexe étant donné que ce dernier cherchait à se présenter comme un penseur sans prédécesseurs directs. Mais c’est surtout le travail de contextualisation qui impressionne. En écrivant, Hitler réagissait souvent à l’actualité, à ces milliers de faits, grands ou petits, immédiatement compréhensibles par ses contemporains et qui constituaient la trame même de l’époque. Il mobilisait, de manière implicite ou explicite, des références, des concepts, des croyances, des habitudes et des réflexes qui, pour la plupart, sont devenus obsolètes pour nous. En fournissant les informations contextuelles nécessaires, les historiens allemands ont permis au lecteur d’aujourd’hui de comprendre ce livre sorti d’un autre âge. Nous avons adapté cet appareil critique pour notre public, en veillant à être aussi concis que possible. Il comporte néanmoins près de trois mille notes, dont la longueur totale équivaut à celle du livre de Hitler lui-même.
Pouvant s’appuyer d’un côté sur le travail de ses collègues munichois, l’équipe d’une dizaine d’historiens et germanistes en charge d’Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf, avait, de l’autre, à effectuer des tâches auxquelles ceux-ci ne s’étaient pas confrontés – à commencer par la traduction. Comme indiqué dans un précédent article, nous avons élaboré un modèle pour restituer la langue de Hitler, qui a servi de base au traducteur Olivier Mannoni pour retravailler son premier jet, puis pour affiner la seconde version au cours de milliers d’heures de révision. Par ailleurs, nous avons désiré accompagner notre lecteur plus loin que ne l’avaient fait nos homologues allemands : nous avons donc ajouté à leur longue introduction générale une introduction spécifique pour chacun des 28 chapitres. Ces introductions, dont la longueur totale équivaut elle aussi à celle du livre de Hitler, comportent en particulier des analyses approfondies permettant au lecteur de déjouer les pièges du démagogue nazi mais aussi de mieux mesurer son leg monstrueux dans l’histoire européenne.
Une édition à vocation citoyenne
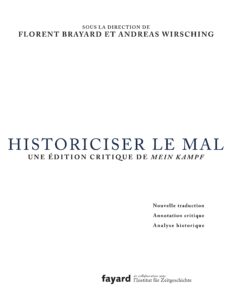
C’est sur ce dernier point, à l’évidence, que les diverses éditions critiques de Mein Kampf s’éloignent du modèle classique de l’édition de sources : nous n’avons pas pu nous contenter de documenter le passé et le présent du livre, comme on le fait usuellement. Nous avons également dû prendre en charge son futur, en décrivant aussi précisément que possible les conséquences que cette idéologie, raciste et fanatique, avait eu sur l’ensemble de l’Europe. Bien qu’il ne constitue pas une feuille de route à suivre dès l’arrivée au pouvoir, Mein Kampf exposait un grand nombre de principes qui allaient fonder la pratique politique de l’Allemagne nazie : abolition du parlementarisme, destruction des partis politiques et dissolution des syndicats, législation raciale et persécution des Juifs et autres minorités, politique révisionniste et expansionniste menant inévitablement à une nouvelle guerre mondiale, etc. À leur manière, les différentes éditions critiques constituent ainsi un mémorial pour les dizaines de millions de victimes du nazisme, dont le sort est rappelé tant dans les notes que dans les introductions de chapitre, du côté français.
La dangerosité extrême de l’idéologie hilérienne se trouve ainsi illustrée par l’exemple, si bien qu’Historiciser le mal, de même que ses divers équivalents européens, a également une visée politique ou citoyenne affirmée : loin de se complaire dans une quelconque neutralité axiologique, elle prend au contraire parti. Cette orientation est particulièrement nette quand il s’agit de dévoiler les mensonges ou les demi-vérités de tous ordres dont Hitler avait décidé de faire le plus large usage, d’un bout à l’autre de son parcours. Ne pas céder sur la dénonciation des mensonges politiques dont les conséquences peuvent s’avérer désastreuses est un combat qui demeure plus que jamais d’actualité à une époque gagnée par le populisme le plus inquiétant.
L’auteur

Florent Brayard est directeur de recherches au Centre National de Recherche Scientifique à Paris. Historien, il a travaillé successivement sur l’histoire du négationnisme puis sur celle de la Shoah. Il est l’auteur de plusieurs monographies, dont « La ‘solution finale de la question juive’. La technique, le temps et les catégories de la décision » (Fayard, Paris 2004) ; Auschwitz, enquête sur un complot nazi (Le Seuil, Paris 2012). En 2021, il a publié chez Fayard, avec Andreas Wirsching, « Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf ».


